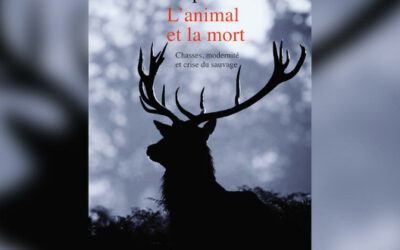Le Groenland… un pays qui fait rêver pour ses glaciers à perte de vue et ses aurores boréales. Mais savez-vous que ce territoire est devenu un laboratoire mondial de recherche sur le climat, parce que les températures s’y sont réchauffées quatre fois plus vite que sur le reste de la planète au cours des dernières décennies ? Pia Scaramiglia, étudiante, y a été faire un stage d’un mois. Elle raconte cette épopée hors du commun et riche en enseignements…
Pia Scaramiglia, pouvez-vous vous présenter ?
Pia Scaramiglia : “j’ai 23 ans et je viens de la région parisienne. J’ai commencé par des études en communication – qui ne m’ont pas passionnée – avant de me réorienter dans un master de gestion des écosystèmes marins et côtiers en Islande, à Isafjörour, petite ville des Westfjords. Pourquoi ces études m’inspiraient-elles tant ? Parce que la cause écologique est très importante pour moi : quand on prend soin des écosystèmes, on prend soin de soi ! Tout est lié, relié, en interaction permanente.
C’est dans le cadre de ce master islandais que j’ai pu partir pendant un mois et demi au Groënland. Une expérience très enrichissante.

Parlez-nous du Groenland
Le Groënland est un très grand pays de 2,2 millions de km2 qui se situe au nord de l’Atlantique, au niveau du cercle polaire arctique. C’est un pays qui appartient au Danemark et qui compte 56 865 habitants – majoritairement inuites – dont 19 872 à Nuuk, la capitale. Chaque communauté – il y a beaucoup de petites villes – habite exclusivement sur les côtes ; au centre du pays, il n’y a que de la glace !
Le Groenland n’est pas si difficile d’accès : il y a un aéroport international et des ports. Le trafic se fait majoritairement par avion et bateau, les routes étant quasi inexistantes.
C’est une zone particulièrement importante pour l’écologie : l’Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste du monde. Il est donc essentiel d’étudier la fonte des glaces et ses impacts sur la biodiversité et les ressources. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de l’international pour effectuer de la recherche, tant en mer que sur la calotte glacière.
Comment avez-vous eu cette opportunité de partir au Groënland ?
Mon extraordinaire aventure au Groënland a donc commencé par ce master islandais Coastal and Marine Management. C’est un master plutôt généraliste, avec, en première année, des cours d’océanographie, d’écologie, et des cours en lien avec l’environnement marin en général. La deuxième année, quant à elle, est consacrée à la rédaction d’une thèse de recherche.
Il se trouve qu’en fin de première année, une opportunité s’est présentée : mon école a été contactée par le pôle climat de l’institut de recherche du Groënland ; les collaborations sont nombreuses et naturelles en zone Arctique. C’est intelligent : ils cherchent de la main d’oeuvre quand nous, étudiants, cherchons des sujets intéressants. J’ai donc, depuis l’Islande, rejoint le Groënland !

Et comment se rend-on au Groënland, depuis l’Islande ?
Jusqu’à la veille du départ, j’avais du mal à croire que j’allais vraiment pouvoir partir !
C’est à Reykjavik que j’ai embarqué sur un bateau de recherche sur lequel j’allais rester dix jours.
Pour être autorisée à participer à l’expédition, il faut signer des papiers, donner son passeport, fournir un certificat médical… Les procédures sont nombreuses.
Et à partir du moment où on arrive dans le bateau, c’est vraiment comme dans un film. J’ai dû affronter deux jours de mal de mer mais ensuite, on vit dans l’action jusqu’à l’arrivée !

À quoi ressemble la vie sur un bateau ?
C’est quelque chose ! Surtout pour quelqu’un qui n’a jamais dormi dans un bateau…
On n’a pas spécialement froid : l’intérieur est chauffé. Et quand on sort, on porte combinaisons, casques et bottes de sécurité qui tiennent bien chaud.
La vie est rythmée par des shifts qui durent 12h. C’est valable pour les deux équipes qui se côtoient sur le bateau : scientifiques (18) et matelots. Avant même le départ, on nous définit un shift. Le mien se déroulait la nuit : de 18h à 6h du matin, ce qui me permettait d’assister au coucher et au lever du soleil !
On dormait en cabines partagées, avec un colocataire travaillant le jour et l’autre la nuit, pour limiter les dérangements.
Comme vous pouvez l’imaginer, 12h de travail d’affilé peuvent fatiguer. Les interactions s’en ressentent parfois ! Il faut être compréhensif, bienveillant et prêt à sortir de sa zone de confort.
Ça donne aussi des circonstances rigolotes, quand on se trouve à changer d’équipe à 6h du matin, que l’on est épuisé, et que l’on pique des fous-rires entre scientifiques parce qu’on n’arrive pas à se comprendre entre ceux qui viennent de Nouvelle-Zélande, d’Espagne, etc. !
Globalement, ce sont des personnes qui ont des états d’esprit positifs et qui, malgré la difficulté du travail, sont contents d’être là. Ils sont bien conscients de vivre quelque chose d’exceptionnel !

Quelles étaient tes missions sur le bateau ?
Chaque scientifique avait sa mission propre : celui qui travaille sur les mammifères n’aura pas besoin des mêmes données que moi qui fait des recherches sur le carbone. Chaque personne s’occupe donc de la data qu’il doit récupérer.
De mon côté, je travaillais avec des carottes sédimentaires. La photo ci-contre montre quelle machine on utilisait pour les récupérer. Ces tubes sont envoyés sous haute pression au fond de l’eau et on espère les voir remonter avec un mètre de sédiments qui seront ensuite analysés en laboratoire pour mesurer quelques données comme la chlorophylle, les nutriments, le carbone…
Le bateau disposait de deux laboratoires : certains traitement ne peuvent pas attendre. Alors, l’heure de plus que l’on doit faire si nécessaire importe peu ! On sait à quel point les moyens mis en oeuvre pour récupérer toute cette data sont chers et précieux.
Comment s’est passée ton arrivée au Groënland ?
Une fois arrivée au Groënland, j’ai donc intégré l’institut de recherche du Groënland pour un mois, à Nuuk. Car récupérer une carotte de boue n’est pas suffisant : il faut ensuite la traiter et l’analyser pour comprendre ce qu’elle a à nous dire. Le travail qui m’y attendait était assez répétitif mais concluant : quelques mois plus tard, j’ai enfin des chiffres exploitable (bien qu’il me manque encore quelques données).
Une journée type serait la suivante : je me réveille le matin, je récupère mes échantillons de boue congelée, je les sèche à 70 degrés, je les réduis en poudre, je les pèse et les mets dans un four à 480 degrés pour en extraire la matière organique – donc le carbone.
L’idée est d’étudier la quantité de carbone stockée dans les sédiments marins. Car dans cette boue au fond de l’eau, à une certaine profondeur, le carbone se trouve piégé et ne ressort plus dans les océans. Grâce à quoi ? Quels sites ont tendance à absorber plus de carbone ? À quelle profondeur le carbone est-il stocké ? Quels facteurs influencent donc ce stockage ? Par exemple, est-ce qu’il y a une température qui correspond à un taux de carbone absorbé ?
Voilà ce que j’essaie de comprendre !

Qu’est-ce qui vous a étonné dans la façon de vivre au Groënland ?
Ce qui m’a vraiment impressionnée, c’est la résilience des populations locales à vivre dans un endroit si hostile pour l’homme – et si magnifique !
J’ai aussi été interpellée par leur rapport à leurs ressources. Là-bas, il y a un lien direct entre les habitants et ce qu’ils consomment. Ils savent exactement ce qu’ils mangent et c’est souvent ce qu’ils pêchent ou chassent sur leur territoire.
Ce n’est pas exactement ce que j’expérimente en France !
Quelles leçons de vie avez-vous tiré de cette expérience ?
La leçon principale, c’est d’apprendre à comprendre les populations et les cultures que l’on ne connaît pas avant de les juger. Je pense notamment à la consommation de mammifères marins – baleine, narval – par exemple, qui peut paraître très choquante à nos yeux.
Les différences culturelles et le rapport au territoire expliquent en grande partie ces pratiques et les justifient souvent.”